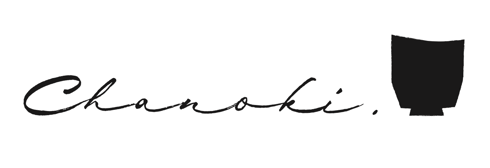Histoire du thé au Japon. Le thé à l'époque Kamakura.
Continuons notre voyage dans le temps, avec l'histoire du thé japonais à l'époque Kamakura.
12/8/20249 min read


Histoire du thé au Japon. Le thé à l'époque Kamakura.
Le moine Yōsai 栄西 (1141-1215) aurait rapporté des graines de théiers de son second séjour en Chine. De retour au Japon, il se lance dans la culture d’un premier champ de thé à Hirado, s’ensuivent d’autres champs. Notons ici que Yōsai serait rentré au Japon au 7ᵉ mois de l’année. Or, nous savons que la récolte de graines de théiers s’effectue au 9ᵉ ou 10ᵉ mois et qu’elles ont tendance à germer facilement. Il est donc peu probable qu’il ait pu rapporter des graines de théier de son séjour. Avait-il en fait rapporté des plants de théiers ? Cela semble plus vraisemblable, à moins que les graines proviennent de théiers japonais.
Les champs de thé de Yōsai sont considérés comme les premiers réellement conçus dans le but d’assurer une production régulière de thé. La première plantation à avoir vu le jour au Japon se situe à Sakamoto, dans la province d’Ōmi.
Le thé — le produit fini — ramené par Yōsai est fragile. Il se conserve avec difficulté, puisqu’il perd en goût, en qualité, etc. Il faut donc en produire annuellement. Ci-dessous, nous assistons à la rencontre entre Yōsai et le shogun Minamoto no Sanetomo 源実朝 (1192-1219) :
[…] Le shogun est un peu malade […] c’est sûrement les restes de son ivresse du banquet d’hier soir. À ce moment-là, le moine Yōsai […] entendit la chose et dit qu’il existait un bon remède. Il fit envoyer depuis le temple du Sūfukuji une coupe de thé et le conseilla [à Sanetomo]. Il y joint un volume de son ouvrage et l’offrit. C’était un livre qui vantait les vertus du thé. On dit que Sanetomo en fut ravi. […] . »
Il s’agit du Kissa yōjōki 喫茶養生記. Yōsai y retranscrit de nombreuses citations d’ouvrages chinois, et grâce à cela, nous disposons d’un aperçu des principales connaissances sur la plante de l’époque. Yōsai offre aussi une sorte de synthèse des méthodes de cueillette et de fabrication du thé qui avaient cours dans la Chine des Song.
Quelle est la méthode de fabrication du thé proposée par Yōsai : il s’agit d’une simple cuisson à l’étuvée, le thé est ensuite grillé. Cette technique a pu se développer facilement au Japon. Quant à la façon de boire le thé, on suppose qu’il s’agissait d’une forme de thé en poudre.
Yōsai fut-il le premier introducteur du thé au Japon ? F. Girard s’interroge sur le temps passé entre le retour de Chine de Yōsai et la rédaction du traité, « son traité [ne serait] qu’un ouvrage de circonstance afin de gagner la faveur des grands du monde » ? Il remarque qu’il a été « à la charnière d’une époque révolue, où le thé est donné à consommer comme médication pour les grands de ce monde, et de temps nouveaux, où l’usage du thé se transforme sensiblement vers un subtil raffinement […] » Yōsai a donc été un promoteur du thé au Japon, et son influence a été significative. L’après-Yōsai voit le début d’une expansion de cette boisson.
Dans le Kantō ōkan ki 関東往還記 (1262) du moine Eison 叡尊 (1201-1290), nous comprenons que la production de thé commence à s’étendre jusqu’à atteindre les provinces du Kantō. Ce texte est publié soixante-dix ans après le retour de Chine de Yōsai, il semble pourtant qu’Eison ait pu consommer du thé tout au long de son voyage entre le Kinai et le Kantō. D’autres moines jouèrent un rôle dans le développement du thé, que ce soit avec des ouvrages tels l’Eihei Shingi 永平清規 de Dōgen 道元 (1200-1253) ou en ayant rapporté des ustensiles nécessaires à des cérémonies liées au thé.
Ils sont tous liés au zen, et la majorité de la production se fait sur les terres appartenant à des temples zen. Chaque thé commence à porter un nom selon sa provenance, ce qui permet de mieux les identifier. La production et la consommation sont concentrées dans les milieux monastiques. La propagation hors de ce milieu paraît avoir été assez lente.
Un thé va bientôt devancer en prestige tous les autres : celui de Toganoo (auj. Kyōto). Le moine Myōe Shōnin (1173-1232) en aurait commencé la production. Ce thé prend plus tard le nom de meicha 銘茶 puis est désigné sous le terme de honcha 本茶, « thé authentique ». Ce nom honcha distingue ce thé du reste de la production du pays, qui est alors désignée sous le nom de Hicha 非茶 « faux thés ».
Le honcha ou les différents hicha, étaient tous fabriqués selon les mêmes procédés, et ne désignaient donc pas des caractéristiques spécifiques. Ces termes de honcha-hicha apparaissent aussi au XIVe siècle dans les rencontres de thé en même temps qu’un nouveau jeu : le Tōcha 闘茶. Ce jeu consiste à deviner d’où provient le thé. Parmi les thés présentés, les participants doivent distinguer le honcha des hicha. En général, on joue avec une dizaine de thés, mais certaines parties peuvent compter jusqu’à 100 thés. Il faut de surcroît découvrir la qualité de chacun des thés.
Il faut attendre le XIIIe siècle pour que des paysans commencent à cultiver du thé sur leurs terres, essentiellement dans les environs de Kyōto. Les paysans ne transforment alors pas eux-mêmes le thé, ce sont les commerçants qui se chargent de cette étape. La production demeure faible et le marché du thé restreint. Le thé reste un produit rare et précieux et se borne aux sociétés cléricales et guerrières. Il reste de nombreux documents qui nous renseignent sur cette consommation de thé et sur l’importation de Chine d’ustensiles servant à sa consommation du thé. Ces objets servaient notamment à décorer les bâtiments d’une résidence noble.
Certaines de ces pièces sont visibles sur le rouleau peint du Boki ekotoba 簿記絵詞(1351). On peut ainsi apercevoir un fouet à thé, des boîtes à thé , ainsi que d’autres ustensiles indispensables à la préparation d’un thé de type matcha.
De la fin de l’époque de Kamakura au début du XIVe siècle, la production de thé s’étend vers le nord. Le thé de Toganoo est à son apogée, les thés d’Uji et de Daigo produisent également des thés de qualité, comme l’atteste le Isei teikin ōrai 異制庭訓往来 de Kokan Shiren (1278-1346) (1).
La multiplication du nombre de centres de production indique que la consommation augmente. Il s’agit bien d’une époque charnière, la production n’est plus cantonnée aux temples. L’expansion a d’abord eu lieu dans des temples autres que zen (Shingon, Tendai, Nichiren, ...). Ces temples ont été à l’origine de la diffusion du thé vers la population, même s’ils répondent d’abord à leurs propres besoins. L’habitude de boire du thé essaime petit à petit dans la population, et plus seulement dans la haute société guerrière ou aristocratique. Un extrait du Shasekishū 沙石集 écrit par Mujū (1227-1312) paraît emblématique de ce mouvement de diffusion du thé des temples vers la population.
Le bouvier demanda : Qu’est-ce que ce remède ?
Ce à quoi le moine répondit : Cela évite la somnolence, aide à la digestion, c’est un remède aux trois vertus.
Le bouvier lui répondit alors : Je finis fatigué de mon travail en journée, si je ne peux pas dormir la nuit, je ne pourrais pas enlever cette fatigue. Je ne mange que des repas pauvres et en faible quantité, si je digère rapidement mon estomac va diminuer petit à petit […] Si c’est ce genre de remède, je n’en veux pas.
Cet échange montre que le thé n’est pas encore connu du peuple. Le bouvier est réticent face au remède que semble lui proposer le moine. Pourtant, la scène donne un exemple de la manière dont les moines ont pu répandre la consommation du thé. Cette hypothèse de la diffusion du thé n’est cependant pas suivie par tous les chercheurs, Hashimoto M. estime que le Shasekishū n’est pas suffisant pour affirmer une quelconque consommation du thé ailleurs que chez les classes dominantes.
Le thé est de plus en plus cité dans les sources, et on constate que la production tend à s’étendre à toutes les régions propices à sa culture. La culture du thé se développe surtout en direction de Kamakura, siège du pouvoir shogunal. Cependant, il semble que la production reste concentrée dans les provinces centrales du Kinai.
Une nouvelle manière de consommer le thé apparaît, comme le décrit Yōsai. On y reconnaît la préparation du thé en poudre. Cette méthode 点茶法 se serait développé à partir de cette époque, d’où date l’apparition du fouet à thé. La première mention de ce dernier se rencontre dans le Daguan chalun 大観茶論 écrit en 1107 par l’empereur Huizong 宋徽宗 (1082-1135). Le thé en feuilles ne disparaît pas, malgré l’absence de sources. Le thé bouilli demeure en effet la préparation la plus instinctive et la plus simple. De plus, le prix élevé du thé en poudre devait le réserver à une élite restreinte.
On compte six manières de désigner le thé : Ha.cha 葉茶, cha. yō 茶葉, matcha 末茶, suri.cha 磨茶, yamacha 山茶, san.mei 山茗. Ha.cha et cha. yō désigneraient des thés décrits par Yōsai et des thés séchés au soleil. Yamacha et san.mei sont des thés cultivés, et le san.mei pourrait être le nom du thé en fonction de sa période de cueillette. Le yamacha désignerait un thé en feuilles. Le suri.cha désignerait lui le ha.cha moulu. Quant au maccha 末茶, à ne pas le confondre avec le matcha 抹茶, on suppose que le terme recouvre deux sens. Le premier désignerait un thé séché au soleil. Les feuilles seraient tellement desséchées qu’elles s’effriteraient beaucoup au point de ressembler à une sorte de poudre de thé. Le second serait de la poudre de thé obtenue à partir de feuilles de thé ha.cha broyées ou moulues. L’analyse des termes désignant le thé pallie en partie le manque de sources en ce qui concerne les techniques de fabrication.
Sources primaires
Azuma kagami dai 4 maki 吾妻鏡第4巻 (Miroir de l’Est 4e volume), Masamune Atsuo 正宗敦夫 (éd.), Tōkyō, Nihon koten zenshū kankōkai, 1930.
Boki ekotoba, 1351 [Ressource électronique]. [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Digital Collection, 2016. Disponible sur : http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2590852.
Chajing 茶経 (Le Classique du thé), VIIIe siècle, Lu Yu 陸羽 (733-804), Catherine Despeux (trad.), Paris, Rivages poche, 2015.
Girard Frédéric, «Traité pour nourrir le principe vital par la consummation du thé, du religieux Yōsai» dans Kissa yōjōki 喫茶養生記 (Traité pour nourrir le principe vital par la consummation du thé), 1211, Yōsai 栄西 (1141-1215), Frédéric Girard (trad.) dans Manabe Shunshō 真鍋俊照 (éd.), Mikkyō bijutsu to rekishi bunka 密教美術と歴史文化 (Beauté du bouddhisme ésotérique et histoire culturelle), Kyōto, Hōzōkan, 2011.
Bibliographie
Ecole Française d’Extrême Orient (éd.), Dictionnaire historique du Japon vol.1, Paris, Maisonneuve et Larose, 2002.
Hashimoto Motoko 橋本素子, « Chūsei ni okeru cha no seisan to ryūtsū – chagyō no seiritsu » 中世における茶の生産と流通ー茶業の成立ー (Production et circulation du thé au Moyen-Âge, formation de l’industrie productive de thé) dans Nishimura Keiko 西村圭子, Nihon kinsei kokka no shosō 日本近世国家の諸相 (Facettes de l’État japonais pré-moderne), Tōkyō, Tōkyō dō shuppan, 1999.
Hashimoto Motoko橋本素子, « Kamakura jidai ni okeru sō kissa bunka no juyō to tenkai ni tsuite – Kenmitsu jiin wo chūshin ni – » 鎌倉時代における宋喫茶文化の受容と展開についてー顕密寺院を中心にー (Acceptation et développement de la culture de la consommation du thé de la Chine des Song à l’époque Kamakura en se concentrant sur le temple Kenmitsu), Nara shien, 2001, n°46.
Hayashi Tatsusaburō 林辰三郎, Zuroku sadō shi 図録茶道史 (Histoire illustrée de la voie du thé), Tōkyō, Dankōsha, 1980.
Guillaume Hurpeau. Histoire du thé au Japon : techniques culturales et de fabrication du thé à l'époque Edo. Histoire. Université Paris sciences et lettres, 2018.
Itō Umeno 伊藤うめの, « Hacha no inyō no rekishi 3 – Kamakura jidai ikō no incha ni tsuite » 葉茶の飲用の歴史 – 鎌倉時代以降の飲茶について (Histoire de la consommation du thé en feuilles 3, à propos de la consommation de thé après l’époque Kamakura), Fūzoku, vol.13, n°1, 1974.
Iwama Machiko 岩間眞知子, Cha no iyaku shi 茶の医薬史 (Histoire médicinale du thé), Kyōto, Shibunkaku, 2009.
Murai Yasuhiko 村井康彦, Cha no yu no rekishi 茶の湯の歴史 (Histoire de la cérémonie du thé), Tōkyō, Tankōsha, 1969.
Murai Yasuhiko 村井康彦, Cha no bunka shi 茶の文化史 (Histoire culturelle du thé), Tōkyō, Iwanami shinsho, 1979.
Musée national de Kyōto, Nihonjin to cha – sono rekishi・sono biishiki : Tokubetsu tenrankai 日本人と茶—その歴史・その美意識 : 特別展覧会 (Les Japonais et le thé. Histoire et sens du beau : exposition spéciale). Kyōto, Musée national de Kyōto, 2002.
Nakamura Yōichirō 中村洋一郎, Bancha to nihonjin 番茶と日本人 (Le bancha et les Japonais), Tōkyō, Yoshikawa Kōbunkan, 1998.
Oka Mitsuo 岡光夫, Nihon nōgyō gijutsu shi – kinsei kara kindai he 日本農業技術史ー近世から近代へー (Histoire des techniques agricoles au Japon, de l’époque pré-moderne à l’époque moderne), Tōkyō, Minerva shobō, 1988.
Ōishi Sadao 大石貞夫, Cha zuisō shūsei 茶随想集成 (Recueil de réflexions sur le thé), Tōkyō, Nōsan gyoson bunka kyōkai, 2004.
Tani Akira 谷晃, Chajintachi no Nihon bunka shi 茶人たちの日本文化史 (Histoire culturelle du Japon des Maîtres de thé), Tōkyō, Kōdansha, 2007.
Teramoto Yasuhide 寺本益英, « Uji cha burando no tenkai to kongo no shinkōsaku » 宇治茶ブランドの展開と今後の振興策 (Déploiement de la marque thé d’Uji et moyen de développement futur), Keizai gakuron kyū, 2004, n°58.
Teramoto Yasuhide寺本益英, « Nihon no cha sangyō no rekishi » 日本の茶産業の歴史 (Histoire de l’industrie du thé au Japon) dans Nōsan gyōson bunka kyōkai (éd.), Cha daihyakka vol.1茶大百科巻1 (Grande encyclopédie sur le thé volume 1), Tōkyō, Nōsan gyōson bunka kyōkai, 2008.
Verschuer Charlotte von, « Le voyage de Jōjin au mont Tiantian », T’oung Pao, n°77, 1991.
Verschuer Charlotte von, Le commerce entre le Japon, la Chine et la Corée à l’époque médiévale, VIIe-XVIe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
Zhang Jianli 張建立, « Heian jidai kara Kamakura jidai ni okeru seicha » 平安時代から鎌倉時代における製茶 (Fabrication du thé de l’époque Heian à l’époque Kamakura), Geinōshi kenkyū, n°155, 2001.
Nos réseaux sociaux
© 2024. Chanoki
Abonnez-vous à notre newsletter